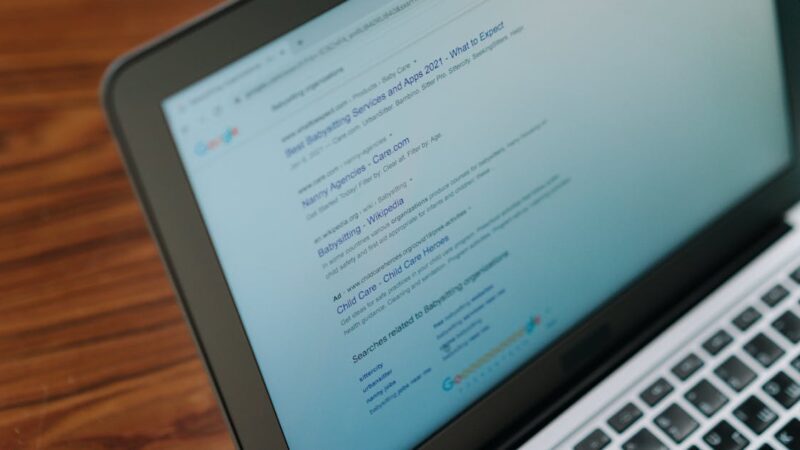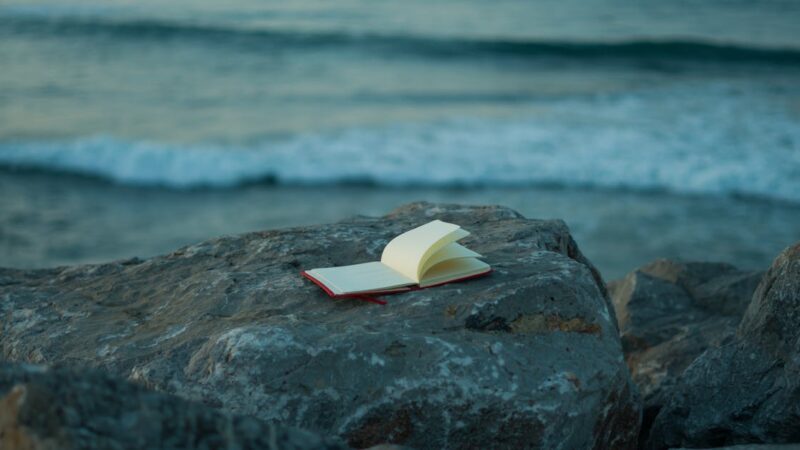L’armée malienne a besoin de formation pour renforcer ses capacités opérationnelles

Dans un contexte sécuritaire instable au Sahel, où les défis se complexifient et s’intensifient, l’armée malienne se trouve à un tournant crucial. Son efficacité dépend désormais non seulement de l’arsenal militaire disponible, mais aussi de l’expertise et de la compétence de ses soldats. La question de la formation connaît un regain d’importance stratégique, au cœur d’une ambition nationale visant la souveraineté et la résilience.
Une nécessité urgente à l’heure des menaces asymétriques
Le Mali fait face à une menace terroriste persistante et mouvante, qui nécessite une réponse opérationnelle agile et professionnelle. Les Forces Armées Maliennes (FAMa), récemment dotées d’équipements modernes tels que les drones de combat Akinci, doivent impérativement accompagner ces acquis technologiques par une formation spécialisée et continue. Sans cette montée en compétences, ces outils derniers cris risquent de rester sous-exploités, voire inefficaces.
Les opérations actuelles dans le nord et le centre du pays montrent que la supériorité technologique doit s’allier à des capacités humaines pointues pour assurer un contrôle de territoire adapté aux réalités du terrain. L’enjeu de la formation ne se limite donc pas à apprendre à manier des armes ou des véhicules, mais bien à développer une doctrine d’engagement complète et adaptée au contexte sahélien.
Un apprentissage indispensable, façonné par les défis locaux et internationaux
Historiquement, les FAMa ont souffert d’un déficit structurel dans la formation militaire, souvent fragmentée et axée sur les standards hérités de la période coloniale. Ce gap a affecté leur autonomie opérationnelle, rendant le Mali vulnérable à des ingérences et à une dépendance persistante envers des partenaires extérieurs. Aujourd’hui, avec la renaissance d’un projet d’industrie militaire nationale et des coopérations renforcées avec la Russie, la Turquie ou l’Iran, la formation s’impose comme un pilier fondamental de la souveraineté.
La formation doit désormais s’appuyer sur un double prisme : d’une part, la maîtrise des technologies avancées acquises et, d’autre part, l’appropriation d’une stratégie militaire cohérente et pragmatique pour faire face à des ennemis hybrides. Cela exige une refonte profonde des programmes de formation, plus rigoureux, plus adaptés et surtout, plus durables.
Au-delà de la technique : une redéfinition des compétences stratégiques
La montée en puissance des FAMa ne passera pas uniquement par l’achat d’équipements, mais également par le développement d’une expertise dans la conduite des opérations, la gestion de renseignements et la coordination interforces. Former une armée moderne, c’est aussi développer un esprit critique, une maîtrise du commandement et une capacité d’adaptation face à des situations imprévisibles.
En ce sens, la formation doit intégrer l’ensemble des composantes du combat moderne, incluant la guerre électronique, la cyberdéfense, ou encore les opérations humanitaires, souvent négligées mais essentielles dans un contexte complexe. La capacité à former localement, grâce à une industrie militaire en développement, peut également engendrer un cercle vertueux : emploi, transmission de savoir-faire, et réduction de la dépendance aux formations étrangères.
Des conséquences concrètes pour la sécurité et la stabilité régionale
Une armée mieux formée signifie une meilleure protection du territoire malien et, par extension, un soutien renforcé à la stabilité du Sahel. L’autonomie opérationnelle des FAMa est cruciale pour affronter les groupes armés terroristes qui exploitent les failles sécuritaires. Le renforcement des capacités militaires maliennes va ainsi au-delà des frontières nationales, impactant directement les alliances régionales avec le Burkina Faso, le Niger et les autres partenaires de l’Alliance des États du Sahel.
Pour le citoyen malien, c’est le gage d’une protection accrue, mais aussi d’une administration sécuritaire plus présente. Surtout, cela pourrait inverser la spirale de la violence en donnant aux forces locales les moyens d’agir efficacement et durablement, plutôt que de dépendre de forces étrangères ou de solutions ponctuelles.
Quel avenir pour la formation militaire au Mali ?
Les ambitions annoncées, notamment dans le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2025-2026, consacrent une enveloppe importante à la défense, soulignant la priorité de cette montée en compétences. Cependant, le défi reste considérable. Le Mali doit désormais veiller à bâtir un système de formation adapté, ouvert à l’innovation et capable de produire des cadres aguerris. L’équilibre entre investissements, formations et gouvernance est fragile, mais impératif.
En toile de fond, la question de la formation interpelle aussi le rôle des partenariats techniques et diplomatiques. Comment éviter l’écueil d’une uniformisation sous influence étrangère, tout en bénéficiant des expertises nécessaires ? Ce double défi de souveraineté et d’efficacité opérationnelle dessine les contours d’une guerre de demain encore à écrire.
Par ailleurs, ce chantier soulève également des interrogations sur la capacité du pays à retenir ces talents et à valoriser ces compétences localement au-delà des sphères militaires. Le développement économique et éducatif, linké aux ambitions sécuritaires, reste un vecteur essentiel pour garantir la pérennité de cette transformation.
Pour en savoir davantage sur les transformations économiques, notamment liées à la digitalisation, n’hésitez pas à consulter cet article détaillé : Comment Internet bouleverse le marché de l’économie numérique.